Impact des actions des cheminots sur la logistique allemande
Contexte stratégique du rail durant l’occupation
Après l’armistice de juin 1940, Berlin exige la remise en service rapide de l’ensemble des grandes lignes métropolitaines. La convention d’armistice transfère à la Deutsche Reichsbahn la haute main sur les sillons horaires ; il en découle un afflux constant de trains militaires, souvent composés de quarante wagons couverts tractés par des 141 R chauffées au charbon français. Les autorités d’occupation considèrent que chaque rame doit franchir 600 km en vingt-quatre heures. Le dispositif ne prévoit pas de réserves importantes : moins de trois jours de stocks locomotives dans beaucoup de dépôts et une marge horaire inférieure à quinze minutes dans les nœuds de triage comme Le Mans ou Châlons-sur-Marne.
Il faut aussi noter que la production sidérurgique hexagonale sert déjà le Reich ; toute altération du flux ferroviaire rejaillit donc sur les aciéries de la Ruhr, puis sur les usines d’armement. Ce lien direct entre atelier français et front russe explique l’acharnement des autorités allemandes à maintenir le trafic quoi qu’il en coûte.
Réseaux clandestins internes à la SNCF
Hiérarchies parallèles
L’organisation clandestine ne repose pas seulement sur les mouvements gaullistes ou communistes. Elle s’appuie aussi sur des cadres moyens restés en poste qui transmettent les ordres en dehors de la hiérarchie officielle. L’ingénieur Jacques Hillairet, par exemple, met en place dès 1941 un double classement des dossiers d’entretien. Les feuilles comportant de faux relevés d’usure partent vers les inspecteurs allemands, tandis que les authentiques valeurs techniques circulent au crayon dans les ateliers. Ce procédé déstabilise la planification des révisions et réduit la disponibilité réelle du parc moteur.
Méthodes de recrutement
Le recrutement s’effectue à l’abri des lampes à acétylène, lors des veilles d’équipe où trois hommes suffisent pour vérifier un essieu. Un ouvrier expérimenté glisse à un jeune stagiaire : « La magnéto du locotracteur 85 manque d’étincelle ce soir », phrase anodine qui signifie que la résistance s’apprête à frapper. Le nouveau venu se voit ensuite confier des tâches graduées : d’abord la diffusion de tracts, puis l’installation d’un pétard d’aiguillage, enfin la responsabilité d’un poste complet. Cette montée en gamme limite les fuites et conserve la discrétion nécessaire au sabotage.
Techniques de sabotage
Altération des voies
L’opération la plus répandue consiste à déserrer les tirefonds d’un rail continu sur vingt mètres, puis à replacer le ballast pour dissimuler l’intervention. Au passage d’une locomotive chargée, l’écartement se creuse, entraînant déraillement à vitesse modérée. Le 12 novembre 1943, sur la ligne Vierzon–Tours, un convoi de ravitaillement du 2e Panzerkorps finit couché sur le flanc : trente wagons de carburant partis en flammes, vingt-quatre heures de fermeture de la ligne principale d’Aquitaine.
Sabotage des locomotives
Dans les dépôts, la limaille de fer devient arme de précision. Introduite dans les boîtes d’essieux, elle raye la portée des coussinets. Après une centaine de kilomètres, la température de l’huile dépasse 120 °C, la fusée ovalise et la bielle maîtresse casse. La locomotive 141 TB 424 affectée au transport de troupes à Nancy est ainsi immobilisée le 5 mai 1944, entraînant la réaffectation urgente d’une machine de réserve et la désorganisation du tableau de marche local.
Manipulation des signaux
Les signaleurs dissimulés derrière les postes d’aiguillage déplacent la lentille du sémaphore pour afficher « voie libre » au lieu de « ralentissement ». Un train suiveur se retrouve alors bloqué sur un canton sursaturé, l’obligeant à stationner plusieurs heures. Ce retard ne détruit pas le matériel, mais il introduit une incertitude qui compromet les correspondances de wagons complets en provenance de la Ruhr. Les pertes cumulées en tonnage expédié se chiffrent en dizaines de milliers de tonnes par trimestre, selon un rapport allemand saisi à Dijon en août 1944.
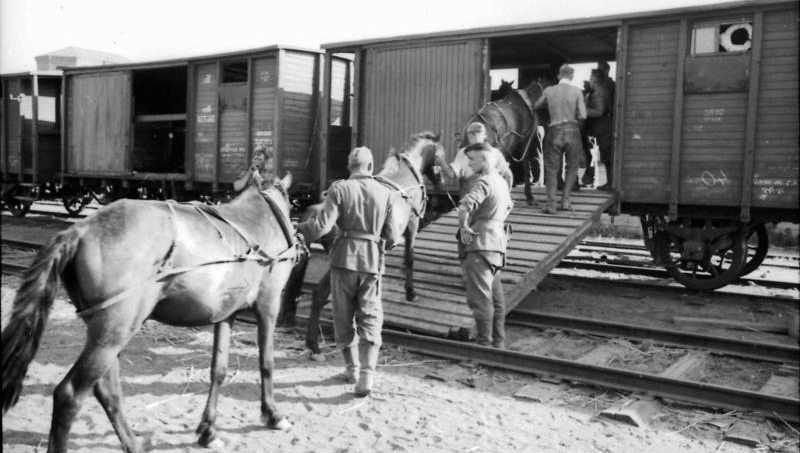
Effets logistiques sur la Wehrmacht
Retards systématiques
L’état-major allemand évalue officiellement la ponctualité à 92 % fin 1941. Ce taux descend à 68 % après l’hiver 1943. L’allongement moyen des trajets dépasse une heure sur Paris–Bordeaux et deux heures sur Lyon–Calais. La cadence des livraisons de carburant aviation aux bases de la Luftwaffe établies à Orly et Cormeilles-en-Vexin tombe à quatre citernes par jour au lieu de six, contraignant certains groupes de chasse à limiter les vols d’entraînement.
Pénurie de matériels
Les retards ne se limitent pas aux fluides énergétiques. Les tubes de 88 mm destinés aux canons Flak arrivent souvent sans leurs culasses, car ces pièces suivent des routes distinctes. Lorsqu’un convoi d’artillerie se retrouve bloqué à Moulins après la destruction d’un pont-rail par le groupe FTP-45, les supposés renforts d’Artillerie-Regiment 84 restent inutilisables trois semaines. Les archives de la Heeresgruppe D signalent alors une baisse de 12 % de la densité de tir antiaérien sur Atlantikwall entre juillet et août 1944.
Surutilisation des routes
Face à l’irrégularité des trains, le Haut Commandement allemand réoriente une partie du trafic vers le transport routier. Les colonnes de camions Opel Blitz et Mercedes L3000 se multiplient sur la nationale 10, puis sur les voies secondaires. L’intendance croit résoudre un problème, mais elle en crée d’autres : consommation excessive de carburant, usure accélérée des pneumatiques importés de Tchécoslovaquie, et exposition accrue aux embuscades de maquisards. Entre Poitiers et Angoulême, les attaques routières enregistrées par la Gestapo passent de deux à huit entre avril et juin 1944.
Adaptation allemande et ripostes
Brigades de réparation
Pour limiter la paralysie des voies, les autorités forment des Bahnbauzüge, trains-ateliers capables de remplacer un coupon de rail en moins de trois heures. Chaque unité emporte grue-portique, foreuses pneumatiques et treillis de pont. Malgré ces moyens, leur intervention demeure tributaire de l’état du ballast et de la couverture aérienne alliée. À partir d’août 1944, l’aviation bombarde systématiquement les équipes de réparation repérées en rase campagne, empêchant le rétablissement rapide du trafic.
Augmentation des escortes
La Reichsbahn exige aussi la présence d’escortes armées dans chaque gare de triage réputée sensible. Le 17e bataillon de sécurité déploie 400 hommes autour de Lens, équipés de mitrailleuses MG 34. Cette concentration limite l’accès aux voies la nuit, mais elle ne résout pas les sabotages exécutés durant les heures d’affluence, quand la présence d’ouvriers civils masque l’action des résistants.
Répression et inspections
Les tribunaux militaires itinérants prononcent plus de 800 condamnations contre des agents du rail entre janvier 1943 et juillet 1944. Malgré la menace, la désorganisation persiste. Les déportations, loin de dissuader, déclenchent des grèves tournantes. Ainsi, le 10 mars 1944 à Marseille, l’arrestation de deux aiguilleurs entraîne l’arrêt simultané de treize postes, bloquant pendant douze heures les convois en partance pour l’Italie.